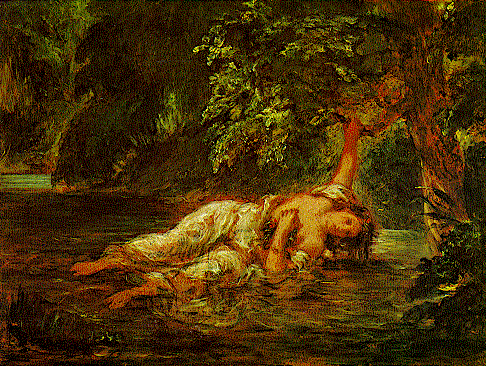« La mort d’une belle femme est sans doute le sujet le plus poétique du monde »

Antoine-Augustin Préault – Ophélie – 1843 (Musée d’Orsay)
Cette affirmation d’Edgar Poë pourrait bien faire figure d’explication définitive et sans nuance du succès que connut Ophélie, triste héroïne d’Hamlet de Shakespeare, auprès des artistes de la fin du XIXème siècle, au point que l’époque transformât bien vite le personnage de théâtre en légende, et la légende en mythe.

Vénus de Lespugue – Profil
Point n’était besoin que nous découvrissions la Vénus de Lespugue, sculptée il y a 25 000 ans dans un bout d’ivoire de mammouth, pour nous convaincre de la force inspiratrice de la Femme. Comment dès lors ne pas concevoir que pour l’artiste de tous les temps ce pouvoir atteigne à son paroxysme lorsque l’objet même de la fascination qui le sous-tend s’expose une ultime fois dans la tragédie de sa disparition.
Shakespeare qui imagine le personnage d’Ophélie et son tragique destin n’aura pas échappé à cette fascination. Fragile Ophélie, docile et obéissante aux injonctions d’un père qui lui interdit son amour pour Hamlet ; faible jusqu’à s’abandonner à la folie et à la mort, après avoir été humiliée et repoussée par cet Hamlet, peut-être fou lui-même, dont elle se croit aimée, et qui, meurtrier de Polonius, son père, la plongera dans les tristesses du deuil.
Pudique et délicat Shakespeare qui, pour nous épargner le douloureux spectacle de la mort de la jeune femme, choisit la voix de la Reine du Danemark pour nous décrire les derniers instants de la belle :
Laërte, frère d’Ophélie, désire se venger d’Hamlet, qui a non seulement tué son père, mais l’a également privé de dignes funérailles . Il vient de mettre au point avec le roi le stratagème qui doit l’amener à accomplir son acte lorsque la reine, à la fin de la scène 7 du quatrième acte, vient annoncer la mort poétique d’Ophélie :
La reine
Un malheur vient sur les talons de l’autre
Tant ils se suivent de près. Votre sœur est noyée, Laërte.
Laërte
Noyée ? Où s’est-elle noyée ?
La reine
Au-dessus du ruisseau penche un saule, il reflète
Dans la vitre des eaux ses feuilles d’argent
Et elle les tressait en d’étranges guirlandes
Avec l’ortie, avec le bouton d’or,
Avec la marguerite et la longue fleur pourpre
Que les hardis bergers nomment d’un nom obscène
Mais que la chaste vierge appelle doigt des morts.
Oh, voulut-elle alors aux branches qui pendaient
Grimper pour attacher sa couronne florale ?
Un des rameaux, perfide, se rompit
Et elle et ses trophées agrestes sont tombés
Dans le ruisseau en pleurs. Sa robe s’étendit
Et telle une sirène un moment la soutint,
Tandis qu’elle chantait des bribes de vieux airs,
Comme insensible à sa détresse
Ou comme un être fait pour cette vie de l’eau.
Mais que pouvait durer ce moment ? Alourdis
Par ce qu’ils avaient bu, ses vêtements
Prirent au chant mélodieux l’infortunée,
Ils l’ont donnée à sa fangeuse mort.
Laërte
Hélas, elle est noyée ?
La reine
Noyée, noyée.
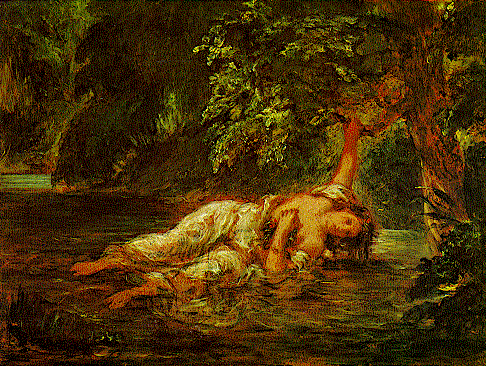
Eugène Delacroix – La mort d’Ophélie (1844)
Peintres, romanciers, poètes, musiciens, du XIXème siècle ont trouvé dans le charme, romantique avant la lettre, d’Ophélie emportée par la folie, par la tristesse et par les eaux, une source intarissable de couleurs, d’images et de sentiments. Autant qu’en pourraient contenir les multiples fleurs dont elle aimait à se parer pour en faire les signes de son ultime langage de vérité.
« La sensibilité romantique française retient d’Ophélie la passion malheureuse et la folie, tantôt égarement amoureux, tantôt douleur morale, aux accents spleenétiques. » écrit Anne Cousseau en introduction de son article « Ophélie : Histoire d’un mythe fin de siècle ». Et un peu plus loin elle précise à juste raison qu’ « En vérité, le romantisme qui impose Ophélie à partir de 1870 est davantage celui des préraphaélites anglais, précurseurs de l’esthétique symboliste. Peintres et poètes, ils libèrent le personnage du texte shakespearien, et l’intègrent à toute une constellation de figures féminines… »
Démodée, périmée, loin aujourd’hui de l’image que veut donner de la femme le « féminisme » contemporain, Ophélie – tant celle de Shakespeare que celle des romantiques du XIXème – projette jusqu’à nous, de manière fantasmatique, son irréalité (ou sa réalité onirique, pour utiliser plutôt une expression positive) qui, sans doute, agit sur nous comme une douce sujétion esthétique chargée d’alimenter le mythe.
Et c’est ainsi que l’on peut encore, parfois, entrevoir Ophélie glisser dans l’encre à peine sèche d’un roman, l’entendre traverser une ballade de Gainsbourg ou de Johnny Hallyday, ou la voir réapparaître, naïve et pâle sur les bords d’un écran.

John William Waterhouse – Ophelia
Séduit, comme au premier jour, par Ophélie retrouvée, j’ai décidé de faire en quelques billets une promenade à sa redécouverte :
- Sur la scène où elle a pris vie, je la regarderai, couronnée de fleurs, sombrer dans la folie et dans la mort ; je l’entendrai « murmurer sa romance ».
- Les poètes me diront comment, « comme un grand lys » jadis elle flottait « sur l’onde calme et noire ».
- Les peintres accrocheront sur les murs de mon musée imaginaire les tableaux qu’elle leur inspira.
- Je suivrai au rythme des mélodies qui la racontent le courant qui l’emporte…
M’accompagnerez-vous ?